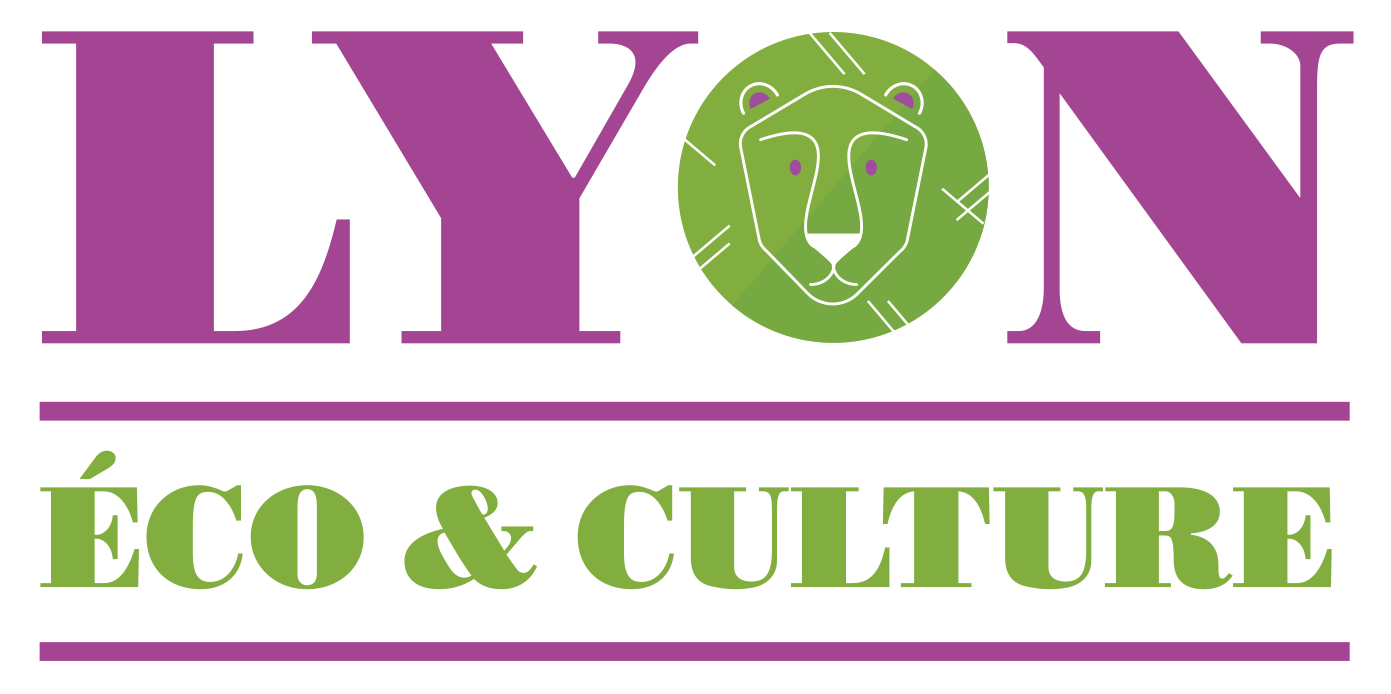Comment Jeux de prédation explore l’économie de survie
Dans le roman Jeux de prédation, Giger COBB montre comment peur et prudence transforment l’économie et la société.
Paru en décembre 2022, Jeux de prédation est un roman de science-fiction post-apocalyptique de Giger COBB, publié par le Cabinet d’édition Plumes Ascendantes, qui imagine un monde où l’économie ne s’effondre pas.
Elle continue. C’est précisément ce qui rend le tableau si dérangeant. L’humanité a survécu à l’Infestation, mais au prix d’une contrainte physique absolue : le bruit et le mouvement attirent des prédateurs aériens mortels. Produire, circuler, commercer, tout devient potentiellement létal. La croissance n’est plus un objectif, elle est un risque.
Sur le plan narratif, Jeux de prédation se présente comme un roman de science-fiction d’action et d’aventure, centré sur John, baroudeur pragmatique évoluant dans un futur hostile, porté par des scènes de tension, une ironie cynique et une structure volontairement vivante.
Mais ce cadre romanesque ouvre aussi la voie à une lecture plus large, où l’univers décrit fonctionne comme une fable sociale, politique et économique.
Le produit intérieur brut n’est même plus mesuré. Non par choix idéologique, mais parce que l’indicateur a perdu toute pertinence dans un monde où la performance met en danger ceux qui la poursuivent. L’économie ne cherche plus à optimiser, elle cherche à se rendre invisible.
Les usines sont enterrées, les villes recouvertes de bâches, les marchés relégués sous terre. Le travail existe toujours, mais il est fragmenté, contraint, hiérarchisé selon son utilité immédiate pour la survie collective. La valeur ne se crée plus par l’innovation ou l’expansion, mais par la discrétion.
Quand les indicateurs disparaissent
Dans Jeux de prédation, l’abandon du PIB agit comme un signal faible mais puissant : lorsque la survie devient la priorité, les outils de mesure hérités de l’abondance cessent d’éclairer l’action.
L’économie fonctionne alors sans boussole macroéconomique, guidée par une administration permanente de l’incertitude.
La mondialisation, elle, n’a pas survécu. Avions et trains ont été abandonnés, trop bruyants, trop rigides. Les échanges subsistent sous une forme dégradée : des convois routiers blindés, lents, rares, reliant des pôles urbains devenus quasi autonomes. Chaque grande ville fonctionne comme une cité-État, défendant ses routes, ses stocks, ses technologies.
Le commerce n’est plus libre, il est négocié, sécurisé, militarisé. L’économie mondiale s’est fragmentée en un archipel de territoires méfiants, où l’information vaut parfois plus que la marchandise.
L’État, en revanche, ne s’est pas effacé. Il s’est renforcé. Rebaptisé « Directoire de Salut public », il administre la société par un système de points de mérite. Travailler, accepter les tâches dangereuses, servir l’appareil productif ou sécuritaire permet d’accéder à des droits différenciés.
L’argent existe toujours, mais il n’est plus structurant. Le véritable capital est la reconnaissance de l’utilité par le pouvoir. La citoyenneté devient conditionnelle, mesurable, révocable.
Une économie du mérite sous contrainte
Le roman décrit une société où les individus ne sont plus des agents économiques autonomes mais des variables de gouvernement de la vulnérabilité collective.
Le mérite remplace le salaire comme instrument central de hiérarchisation sociale, instaurant une forme de servitude rationnelle.
Dans un monde saturé d’angoisse, la productivité ne tient que par la régulation chimique des affects. Les psychotropes sont distribués massivement pour prévenir la panique, lisser les comportements, maintenir l’effort. La santé mentale devient une variable macroéconomique.
L’anxiété est un coût. La lucidité aussi. L’économie ne repose plus seulement sur des flux matériels, mais sur une rationalisation industrielle des émotions.
Quand l’ennemi devient une variable économique
À mesure que le récit progresse, les xénoptères cessent d’être de simples figures de menace. Ils apparaissent organisés, intelligents, capables d’apprentissage. Le pouvoir humain tente d’abord de les combattre, puis de les comprendre, avant d’envisager l’impensable : composer avec eux.
L’ennemi devient une contrainte intégrable, parfois négociable. Le Directoire finit par traiter avec lui, non pour la paix, mais pour préserver ses intérêts économiques et politiques face à d’autres cités rivales.
Rationalité cynique
Le roman explore la capacité d’un système à intégrer une hostilité permanente tant qu’elle reste prévisible et exploitable.
La menace n’est plus un dysfonctionnement, mais un paramètre de mise en calcul stratégique.
Ce glissement est au cœur du propos. La morale devient secondaire face à la stabilité. La survie collective justifie la manipulation de l’information, la hiérarchisation des vies, les accords tacites avec la menace elle-même. L’économie ne cherche plus le bien commun, mais la continuité du pouvoir qui l’organise.
Relu avec le recul de quelques années, Jeux de prédation apparaît moins comme une dystopie spectaculaire que comme une fable économique rigoureusement logique. Tout continue : travailler, produire, commercer, gouverner. Mais au prix d’un basculement progressif vers une société administrée par la peur, la rareté et la sédation.
Le roman ne prétend pas dire l’avenir. Il extrapole des dynamiques déjà à l’œuvre : fragilité des chaînes logistiques, gouvernance par l’exception, normalisation de l’urgence, anesthésie sociale comme condition de la performance.
Une économie capable de survivre à presque tout, sauf peut-être à la question la plus dangereuse de toutes : pourquoi continuer ainsi. Cette question, le roman la laisse volontairement ouverte — et c’est sans doute là qu’il touche le plus juste.